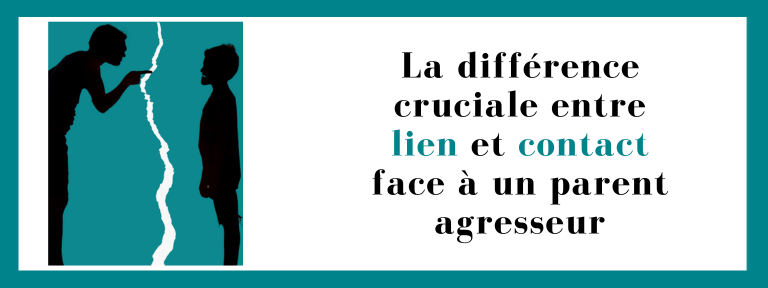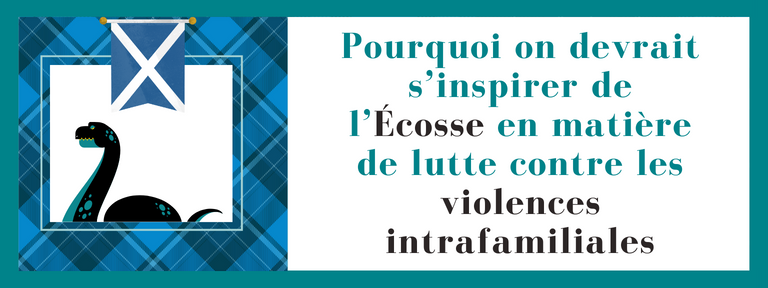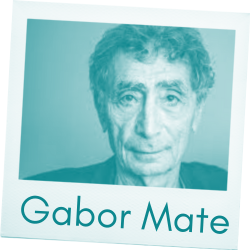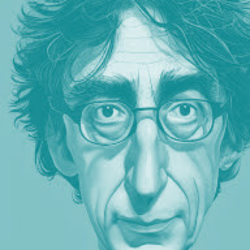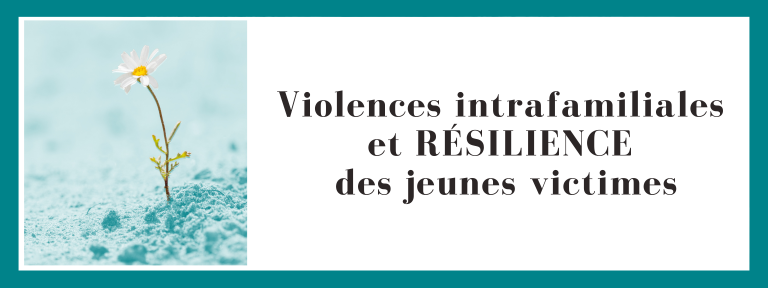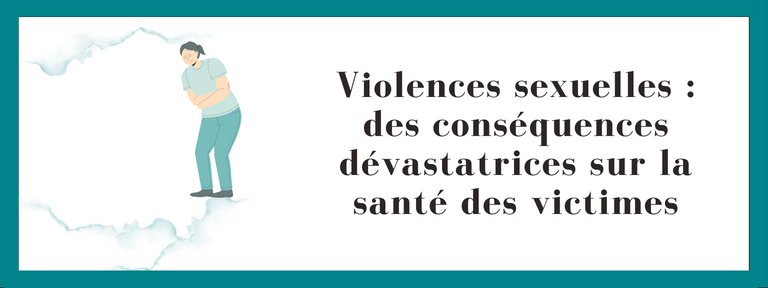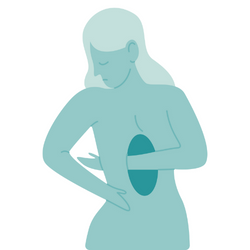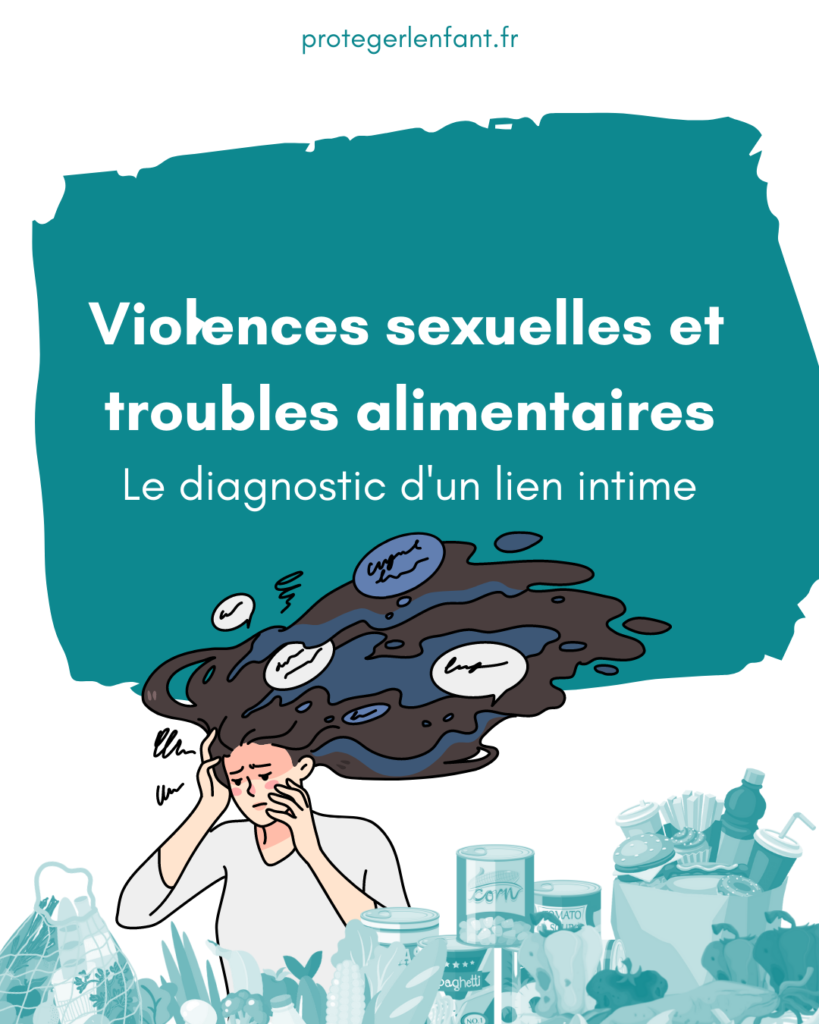Maintenir le lien ou le contact entre un enfant et son parent dangereux ?
- Le lien fait référence à la connexion biologique, légale ou émotionnelle réciproque qui existe entre un enfant et ses parents ou autres membres de la famille. Ce lien est souvent perçu comme inaliénable et fondamental pour le développement de l’identité de l’enfant. Il est associé à des notions de patrimoine, d’héritage culturel et familial, et d’une continuité à travers les générations.
- Le contact, en revanche, se réfère à l’interaction physique ou communicationnelle entre un enfant et un membre de sa famille. Il est possible de réglementer, limiter ou superviser ces interactions en fonction de ce qui est considéré comme étant dans le meilleur intérêt de l’enfant.
La distinction entre « lien » et « contact » est fondamentale lorsqu’on aborde la question de la nécessité ou non de maintenir des relations familiales en présence de violences intrafamiliales, entre des enfants victimes et des parents potentiellement dangereux. Cette différence prend une importance cruciale dans le contexte judiciaire et social, où les acteurs de la protection de l’enfance ne sont pas toujours assez formés sur ces notions.
La chercheuse canadienne Suzanne Zaccour explique :
« Les juges et les expert·es vont souvent considérer qu’il faut maintenir le lien père-enfant à tout prix, même en cas de violence familiale. Pourtant, le mythe selon lequel un enfant a absolument besoin de contacts avec ses deux parents, même en cas de violence, a été démenti par les sciences sociales, qui montrent plutôt que l’enfant a besoin d’une relation solide et sécuritaire avec la principale figure parentale.«
Derrière le choix de maintenir un lien ou stopper le contact, se cache les gros pavés de l’autorité parentale et des droits de visite.
La société a tendance à penser que dès qu’il y a la filiation, il faut qu’il y ait absolument l’autorité parentale + le lien + la rencontre (le contact).
L’argument pour préserver le lien entre l’enfant et l’agresseur repose sur la fausse croyance que chaque parent a un rôle essentiel à jouer dans la vie de l’enfant, indépendamment de son comportement. Cette vision passéiste masque l’impact des violences subies par l’enfant, voire les renforce. Les professionnels devraient savoir que perpétuer un contact parent agresseur/enfant est très nocif, très traumatisant pour les victimes.
On le sait, on le voit, les espaces rencontres ne transforment pas un parent violent en bon parent. De même, le maintien d’un droit de visite est pour l’agresseur la preuve que finalement ce qu’il a fait n’est pas si grave, qu’il n’y a pas de danger, vu qu’il peut continuer le contact avec ses victimes…
Soutenir un parent violent dans sa parentalité au prétexte erroné qu’un enfant a besoin de ses 2 parents pour se développer, c’est faire preuve d’une grande méconnaissance de l’impact des violences faites aux enfants. Un enfant a besoin d’amour et de sécurité. Peu importe le nombre ou l’identité des personnes qui répondent à ces urgences vitales.
Et on revient alors à la différence entre le lien et le contact. Jean Louis Nouvel, pédopsychiatre, précise :
“ Le lien c’est psychique, le contact, c’est physique”.
Couper le contact est la seule option pour qu’un jour, peut-être, il existe à nouveau un lien en bonne santé.
Si on veut aider les victimes, il faut savoir couper le contact, pendant une période suffisamment longue. L’enfant a besoin du temps de la cicatrisation, de la prise en compte de ses traumatismes, du phénomène d’emprise. Il faut que la peur recule, que la confiance gagne du terrain. Et cela, seul l’éloignement total avec l’agresseur peut le permettre. On n’avance pas dans sa guérison en côtoyant son bourreau. Et les bourreaux ne doivent pas se servir des enfants comme médicaments.
Un jour, si l’enfant est protégé, s’il se sent assez fort, s’il en a envie, il pourra reprendre le lien avec le parent qui le maltraitait. A son rythme.
D’ici-là, maintenir le contact ne rend service à personne. Ni à l’agresseur qui en retire un sentiment d’impunité et qui peut perpétuer les violences en accusant l’autre parent d’aliénation. Ni aux victimes qui ressortent de ces rencontres avec de la peur, un traumatisme renforcé et une perte de confiance vis-à-vis des professionnels qui ne prennent pas leur parole au sérieux.
La question finale est qui voulons nous protéger ?
Si on veut vraiment aider l’enfant à se « délier » de l’emprise psychologique de l’agresseur, cela passe par une rupture avec l’agresseur.
Les contacts doivent cesser pour préserver le bien-être psychologique de la victime.
Stopper le contact pour garantir que les enfants puissent vivre une vie sans être constamment hantés par les traumatismes passés.
Cela inclut de pouvoir dormir paisiblement, apprendre efficacement à l’école et interagir avec leurs pairs sans être submergés par les souvenirs traumatiques.
La Justice doit comprendre l’importance d’une approche centrée sur l’enfant, où les décisions concernant l’autorité parentale, le lien, le contact, sont prises en tenant compte de leur impact sur la santé mentale et physique de l’enfant, et non pas uniquement sur la préservation des structures familiales traditionnelles ou des droits parentaux.