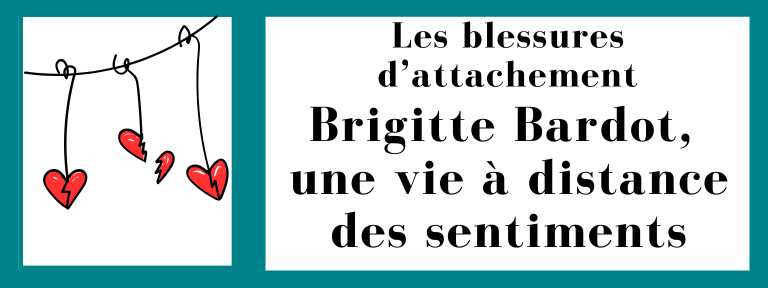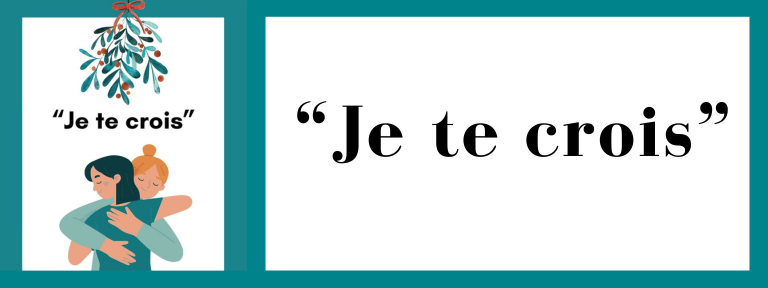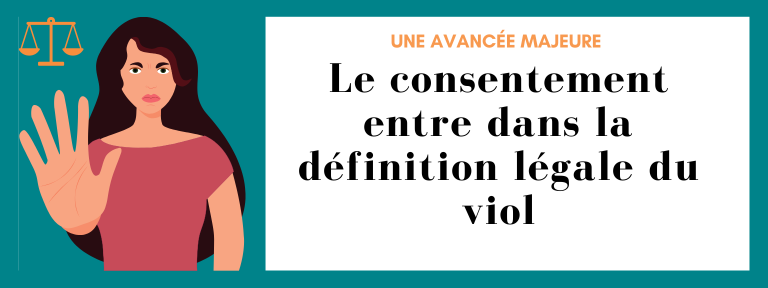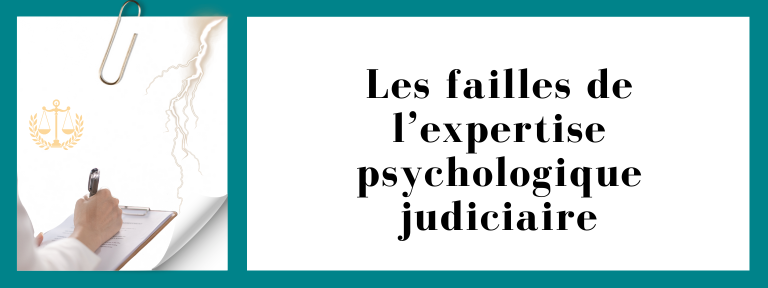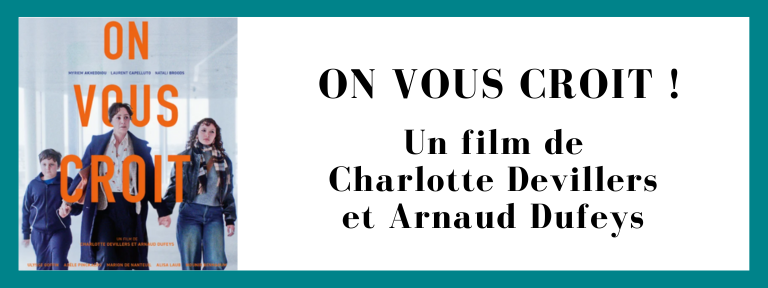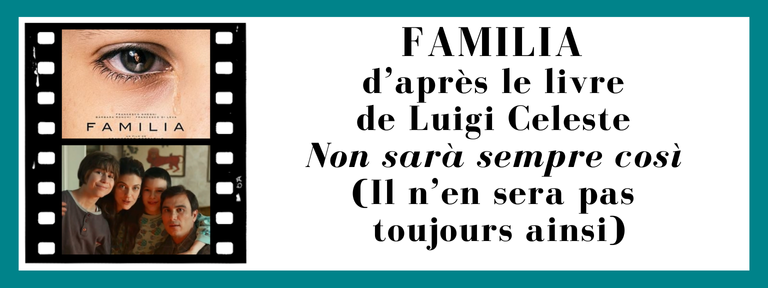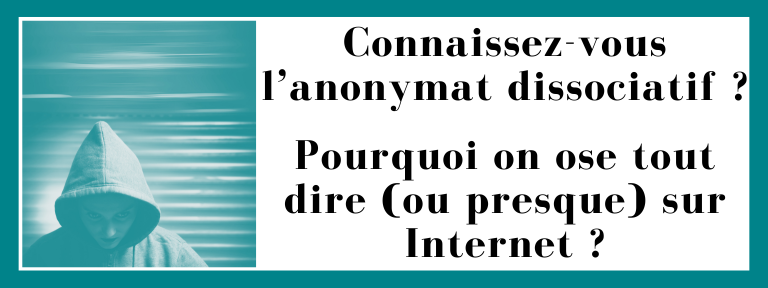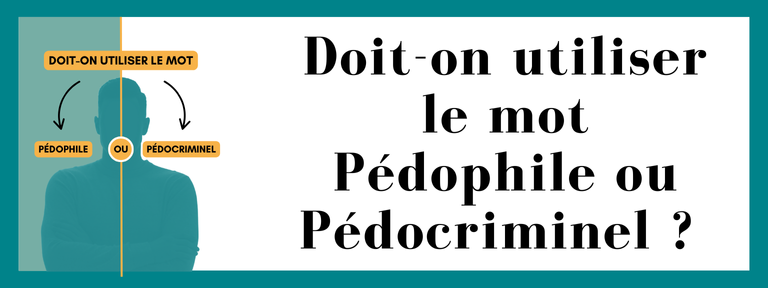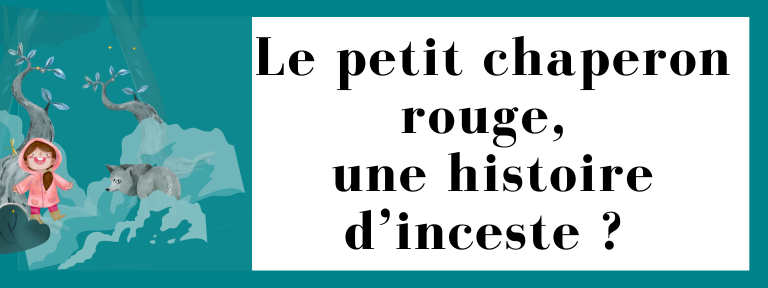Par Caroline Bréhat, psychothérapeute, psychanalyste et autrice
N’est-il pas ironique que la femme la plus admirée du monde était rongée par un grave désamour de soi ? Une blessure d’attachement qui pourrait expliquer ses liaisons éphémères avec les hommes, l’abandon de son fils, sa passion dévorante pour les animaux. Jusqu’à ce statut d’objet sexuel qu’elle a par la suite tant dédaigné.
Le regard désaimant d’une mère narcissique
Petite, Brigitte Bardot était considérée par sa mère, Anne-Marie Mucel, comme une enfant au « physique ingrat » par rapport à sa sœur Mijanou, la préférée de ses parents. Enfant et adolescente, Brigitte ne trouve jamais grâce auprès de sa mère violente et hyper contrôlante.

Sa mère, figure d’attachement effrayante, n’hésite pas à gifler sa fille « lorsque son corps s’affaisse ». Enlaidie par un appareil dentaire et des lunettes, Brigitte est amblyope : son œil gauche est aveugle, en raison d’une mauvaise connexion avec son cerveau. La jeune Brigitte intériorise le regard dévalorisant de sa mère et fait une tentative de suicide à 15 ans : « Quand j’étais petite, je ne me sentais pas très belle, j’étais renfermée sur moi-même. Mijanou, ma sœur, était plus jolie que moi. Je n’étais pas bonne élève et mes parents n’étaient pas très fiers de moi. »

Mais qui est donc cette mère qui n’hésite pas à la frapper à coups de cravache ?
Actrice et danseuse contrariée « qui ne s’aime que lorsqu’elle est regardée », Anne-Marie Mucel, issue comme son mari de la haute bourgeoisie catholique, tente de faire de sa fille une sorte de disciple : « J’ai été élevée par des parents de droite, d’une bourgeoisie austère, qui m’ont donné une éducation assez stricte. J’ai connu la cravache… J’allais dans une école catholique, j’étais surveillée avec une gouvernante. Je ne sortais jamais dans la rue toute seule. J’ai été très tenue jusqu’à l’âge de 15 ans », explique Brigitte Bardot dans ses mémoires publiés en 1996, Initiales BB.

Si Brigitte rêve d’intégrer l’Opéra de Paris et de devenir une étoile, c’est pour briller un peu dans les yeux de cette mère mal-aimante.
Mais rien à faire, même lorsque Brigitte fait la couverture du magazine Elle en 1950, dont le numéro spécial est dédié à la relation parents-enfant, où elle apparaît debout derrière sa mère, la légende entourant la future actrice la condamne : « Les jeunes filles sont-elles détestables ? Les jeunes mères sont-elles irréprochables ? ».
Seul son grand-père maternel, Léon Mucel, la soutient dans son projet d’actrice, mais c’est en des termes particulièrement méprisables qu’il parle de sa petite fille, la ramenant à un statut d’objet sexuel : « Si cette petite doit un jour être une putain, elle le sera avec ou sans le cinéma. Si elle ne doit jamais être une putain, ce n’est pas le cinéma qui pourra la changer ! Laissons-lui sa chance. ». Comment s’aimer lorsqu’une famille toute entière vous méprise autant ?
De ce désamour de soi naîtra un attachement insécure évitant qui expliquera son comportement avec les hommes.
De l’attachement insécure évitant à l’autodestruction
Les neuroscientifiques parlent de modèle interne opérant pour décrire le style d’attachement qu’un parent transmet à son enfant. Un enfant rejeté qui ne bénéficie d’aucun contact physique aura tendance à se blinder et à taire ses émotions pour se protéger. Pour s’adapter à cette adversité, il mettra souvent en place un attachement évitant et manifestera une indépendance excessive qui l’empêchera d’établir des liens profonds avec les autres. Cet enfant en arrive à se détester et peut considérer les autres – les hommes, pour Brigitte Bardot – comme intrusifs à l’image de son parent maltraitant. Fiables uniquement lorsqu’ils sont tenus à distance.
Brigitte Bardot croque les hommes, les maltraite puis les jette. Dix-sept hommes, 4 mariages, de multiples infidélités, liaisons extra-conjugales éphémères, Brigitte Bardot montre une indépendance excessive : « Je suis infidèle. J’ai beaucoup d’amants, non par perversité, mais par tendresse, » confie-t-elle. Ou bien « l’amour, ça ne dure que trois mois ! ». Elle se marie avec Gunther Sachs mais refuse de partager son appartement. Cette indépendance, elle la chante d’ailleurs dans la chanson écrite par Serge Gainsbourg : « Je n’ai besoin de personne… » L’actrice semble préférer la quantité à la qualité, c’est-à-dire à l’engagement émotionnel. De fait, même au fait de sa gloire, lorsqu’elle incarne dans « Et Dieu créa la femme », l’idéal féminin fantasmé de l’époque, Brigitte ne se trouve toujours pas belle.
Ce n’est pas tant de sa plastique dont il est question, mais plutôt du peu de valeur qu’elle s’accorde réellement. Et les pensées morbides ne sont jamais très loin : « À des périodes de ma vie, pour échapper à ce tourbillon insensé, j’avais même un tube de somnifères constamment à portée de main. » Le 28 septembre 1960, le jour de ses 26 ans, Brigitte Bardot fait une deuxième tentative de suicide qui laisse le monde éberlué.
Mais c’est peut-être sa relation avec son enfant, Nicolas, issu de son union avec Jacques Charrier, qui symbolise le mieux cet attachement évitant : « Je n’ai jamais eu d’instinct maternel », déclare Brigitte Bardot, Dans ses mémoires, elle évoque son accouchement en des termes terribles : « C’était un peu comme une tumeur qui s’était nourrie de moi, que j’avais portée dans ma chair tuméfiée, n’attendant que le moment béni où on m’en débarrasserait enfin… Le cauchemar, arrivé à son paroxysme, il fallait que j’assume à vie l’objet de mon malheur. (…) Impossible, je préférais mourir » … Avant d’ajouter, incongrue, dans une autre interview : « J’aurais préféré accoucher d’un petit chien ». Et de fait, Brigitte Bardot semble trouver épanouissement et équilibre uniquement auprès de ses animaux à la Madrague. Logique, avec un animal, l’amour ne fait pas mal, l’engagement émotionnel ne fait craindre aucun risque d’abandon ni de rejet. Nombreux sont les attachements évitants qui trouvent plus rassurant de se lier à des animaux qu’à des humains.
Brigitte Bardot a fait deux tentatives de suicide. Elle a abandonné une carrière prometteuse de danseuse à 18 ans et une carrière d’actrice à 38 ans là où d’autres sont encore dans la fleur de l’âge.

Elle a multiplié les liaisons et relations sentimentales, confié son enfant à son mari et fait des déclarations infâmantes dans le cadre de son militantisme en faveur des animaux. Celle qui avait été surveillée par sa mère et sa gouvernante, puis épiée par les paparazzis et emprisonnée dans un rôle de femme-objet a joué des rôles de femme libre. Mais elle a été contrainte de fuir des situations qui impliquaient une proximité émotionnelle de crainte de réactiver les blessures de son enfance. Brigitte Bardot était tout sauf une femme libre et sa vie incarne parfaitement les dérives autodestructrices d’un attachement insécure évitant.
Article de Caroline Bréhat, psychothérapeute, psychanalyste et autrice. Article reproduit avec son aimable autorisation.
Source : L’Humanité https://share.google/udTIVJtGoWhGLWjG3
Vous pouvez trouver d’autres articles de Caroline Bréhat ci-dessous ::https://www.protegerlenfant.fr/2021/10/17/syndrome-alienation-parentale-2/