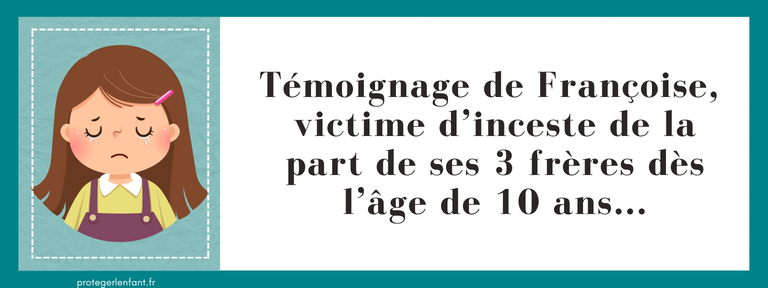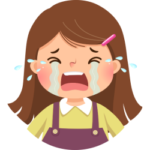Nom masculin, d’origine anglaise
Le grooming désigne une stratégie de manipulation utilisée par des agresseurs pour gagner la confiance d’un enfant (ou parfois d’un adulte vulnérable) en vue de l’exploiter, notamment sexuellement.
Grooming : ce que la loi française refuse encore de nommer
Dans les affaires de violences sexuelles intrafamiliales, la France continue de peiner à appréhender certaines formes d’agression pourtant bien connues des cliniciens, des victimes… et des agresseurs. L’un des angles morts les plus criants reste la notion de grooming.

Ce mot n’a toujours aucun équivalent juridique en droit français alors qu’il est pourtant central dans les législations anglo-saxonnes.
Une absence aux conséquences lourdes.
Le grooming, qu’est-ce que c’est ?
Dans les pays anglo-saxons, le grooming est défini comme un processus intentionnel de manipulation mentale, affective et parfois logistique, mis en place par un agresseur pour obtenir la soumission ou le silence de sa victime, souvent un mineur.
Il précède généralement les actes d’agression sexuelle et en constitue le terreau psychologique. Le mot signifie littéralement “faire la toilette”, “soigner l’apparence”. Un euphémisme cruel qui rappelle la manière feutrée et insidieuse dont ces agressions s’introduisent dans la vie des victimes.
Au Royaume-Uni, la loi sur les infractions sexuelles définit clairement le grooming comme une infraction distincte, passible de jusqu’à 10 ans de prison, dès lors qu’un adulte engage un échange intentionnel avec un mineur en vue d’un acte sexuel.
Aux États-Unis, de nombreux États criminalisent explicitement le child grooming, y compris dans ses formes numériques (cyber-grooming), et les forces de l’ordre sont formées à repérer ces pratiques.
En France, rien de tel. Le code pénal continue d’aborder les violences sexuelles presque exclusivement sous l’angle de la violence physique, de la contrainte, de la menace ou de la surprise.
Le grooming se déroule souvent en plusieurs étapes :
- Création d’un lien de confiance : l’agresseur se montre bienveillant, offre une attention particulière, se positionne comme une figure de soutien ou d’amitié.
- Isolement : Il tente d’éloigner la victime de ses proches, de la rendre dépendante émotionnellement.
- Introduction de la sexualisation : Par des discussions, des images, des sous-entendus, l’agresseur banalise des comportements inappropriés.
- Contrôle et silence : Il utilise la culpabilisation, la peur ou le chantage pour maintenir la victime sous emprise et l’empêcher de parler.
Le souci est que tout ce “travail préparatoire”, cette installation d’un climat de domination psychique, d’isolement ou de confusion, ne sont pas reconnus comme une méthode d’agression à part entière.
Cette lacune a des effets très concrets sur les affaires judiciaires. Lorsqu’il y a violence physique manifeste, la question du consentement ne se pose pas : les faits parlent d’eux-mêmes. Mais dans les cas où l’agression s’inscrit dans un processus lent et dissimulé, que ce soit dans une famille, une école, un club sportif ou un cadre religieux, la justice française interroge la victime plutôt que l’agresseur. A-t-elle dit non ? Pourquoi n’est-elle pas partie ? A-t-elle envoyé des messages ambigus ?
Exemples concrets :

- Un adulte qui discute avec un enfant sur un jeu en ligne et l’amène progressivement à partager des photos inappropriées.
- Un proche de la famille qui devient “l’ami” privilégié d’un enfant en lui offrant des cadeaux et en cultivant une relation exclusive avant d’introduire des comportements abusifs.
- Un enseignant, coach, ou toute autre figure d’autorité qui utilise sa position pour manipuler un enfant et obtenir des faveurs sexuelles sous couvert d’affection.
Pourquoi le Grooming est un problème majeur ?
Le grooming est particulièrement pernicieux car la victime peut ne pas réaliser qu’elle est manipulée et croire qu’il s’agit d’une relation normale. Cela rend la dénonciation et la prise de conscience encore plus difficiles. Le cyber-grooming est aussi une menace croissante. Les prédateurs contactent des enfants via les réseaux sociaux, les jeux en ligne, etc, et se font passer pour des amis.
L’agresseur peut s’en prendre à plusieurs enfants en même temps mais selon des modalités ou des moments différents. Parfois, ces derniers ignorent que leurs frères ou sœurs sont aussi victimes.
Ce qu’apporterait une reconnaissance du grooming
Inscrire le grooming dans la loi, c’est reconnaître l’existence de stratégies prédatrices spécifiques, qui exploitent la confiance, la dépendance, l’admiration, la peur ou la solitude des enfants. C’est aussi former les magistrats, les avocats, les enquêteurs, les cliniciens à repérer ces schémas.
Cela permettrait de poser d’autres types de questions lors des procédures judiciaires. Au lieu de scruter la victime, on pourrait viser l’agresseur et ses actes : Pourquoi avez-vous demandé le silence sur vos échanges ? Comment avez-vous gagné sa confiance et organisé son isolement ? Pourquoi tous ces cadeaux ?
En refusant de nommer le grooming, la loi française refuse de voir ce que les victimes, les cliniciens et même les agresseurs savent depuis longtemps : la violence sexuelle ne commence pas au moment de l’acte. Elle prend racine bien avant, par des gestes d’approche, des phrases banales, des attitudes faussement bienveillantes. Elle commence là où l’intention prédatrice se dissimule sous un masque d’innocence.
C’est cette dissimulation qui doit être mise en lumière, non seulement dans les textes, mais aussi dans les pratiques judiciaires, les formations professionnelles, l’écoute clinique.
Reconnaître le grooming, c’est se doter d’outils pour mieux protéger les enfants, mieux juger les crimes, mieux réparer les victimes.