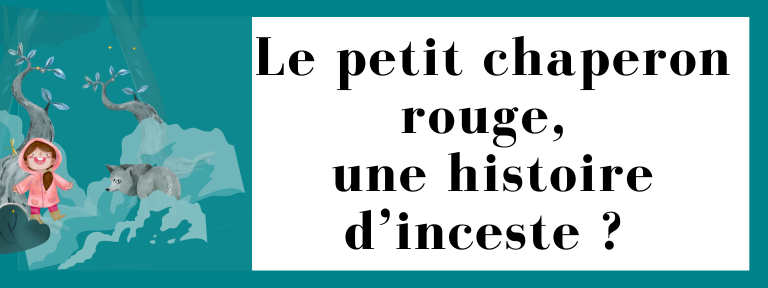On connaît tous l’histoire du Petit Chaperon rouge. Le loup, la forêt dangereuse, la grand-mère, la fillette naïve, la morale de Charles Perrault qui met en garde les jeunes filles contre les inconnus…
Et si, depuis des siècles, nous étions passés complètement à côté de l’essentiel ? Et s’il s’agissait là d’un faux-semblant ?

C’est la thèse passionnante que défend Lucile Novat dans son essai De grandes dents, enquête sur un petit malentendu (Éditions La Découverte, 2024), présentée dans une émission de France Culture.
Un ouvrage qui relit ce conte fondateur et en bouleverse la signification.
La réécriture du danger : de l’extérieur à l’intérieur
On voit habituellement ce conte comme une mise en garde contre les dangers de la forêt, de l’étranger. Pour Lucile Novat, c’est en réalité tout l’inverse. Le danger n’est pas un inconnu qui rôde dehors, un monsieur qui offre des bonbons, c’est un proche, inscrit au cœur de la maison familiale, voire au lit. Selon elle, le loup serait une métaphore d’un père incestueux, dont l’acte violent est camouflé derrière la fable du prédateur sauvage.
Elle illustre ce pivot à partir de l’image mythologique : tout comme dans le mythe de Cronos, la figure parentale abusive se mue en créature monstrueuse. Le conte devient alors une métaphore contemporaine des violences intrafamiliales que l’on connait bien.
Le loup agresse à l’intérieur
Un détail qui n’en est pas un : pourquoi le loup ne dévore-t-il pas le Petit Chaperon rouge lorsqu’il la rencontre dans la forêt ? Il en aurait pourtant la possibilité. Mais non : il attend que la fillette soit entrée dans la maison, dans l’espace intime et clos, là où personne ne peut voir, ni entendre. C’est une stratégie typique des agresseurs : agir à l’abri des regards, dans le secret du foyer.

Autre similitude, le loup ne reste pas un loup, prédateur évident. Il ne surgit pas pour mordre, il opte pour une autre stratégie. Il se déguise en grand-mère, figure d’autorité et de confiance pour maquiller sa violence derrière un masque respectable, il travestit son apparence pour mieux tromper.
Ce basculement de la menace visible à la menace dissimulée et enjôleuse rappelle des mécanismes bien connus des violences sexuelles intrafamiliales :
- L’agresseur se fait passer pour protecteur. Il abuse de la confiance naturelle que l’enfant accorde.
- Il travaille son emprise, cherchant à convaincre de sa bienveillance, pour mieux abuser.
- C’est un opportunistes qui vise l’impunité.

Le conte met en scène explicitement, la logique perverse de l’inceste : le danger ne vient pas de l’extérieur, de l’inconnu, de l’étranger, mais de l’intérieur, de la famille, du domestique.
Il porte le masque de la tendresse pour mieux violenter ses victimes.
D’autres indices plus psy semés dans le texte
- La “folie” des femmes, dès les premières lignes : Perrault insiste sur une affection excessive, obsessionnelle, jusqu’à la “folie”, pour le personnage de l’enfant. Un amour puissant que Novat suggère comme un possible symptôme de dérive émotionnelle et sexuelle.
- La chevillette et la bobinette : ce mécanisme complexe de fermeture symbolise une forteresse censée protéger, mais aussi une mise en scène artificielle du danger extérieur (un leurre pour masquer ce qui est véritablement menaçant à l’intérieur).
- Trouble entre les genres et les rôles : la fillette est évoquée au masculin (“le petit chaperon rouge”), tandis que la grand-mère-loup est décrite avec des attributs masculins (corps velu, poils impressionnants).
Relu ainsi, Le Petit Chaperon rouge devient le récit d’un danger intime et indicible : l’inceste, que la littérature populaire a masqué derrière la figure commode du loup.
Là où la société continue de maintenir l’illusion d’une violence qui viendrait surtout de l’extérieur, l’enseignante Lucile Novat cherche à faire émerger une réalité plus glaçante.
Elle raconte que quand elle introduit Le Petit Chaperon rouge dans sa classe de sixième, le conte libère la parole des élèves et ouvre une occasion de sensibilisation, de prise de conscience. Il permet également aux adultes accompagnants de trouver des médiations justes et sensibles avec les enfants.

Le conte devient une boîte à outils pour penser l’indicible.
En France, l’inceste reste largement tabou : selon la Ciivise, 1 enfant sur 10 est victime de ces violences. Notre imaginaire collectif masque ce drame et le conte du Petit Chaperon rouge contribue, malgré lui, à occulter cette réalité.
Changer de regard sur ces lectures, c’est faire bouger un discours figé, retrouver tous les jours un peu plus une parole tétanisée par le secret. C’est aussi redonner aux parents, aux enseignants, aux institutions, des outils symboliques et analytiques pour accompagner les enfants victimes, sans retomber dans la censure du réel.

Luttons contre ces faux loups.
La maison, le territoire où les violences se commettent sans témoins, doit redevenir un lieu de paix et sécure.