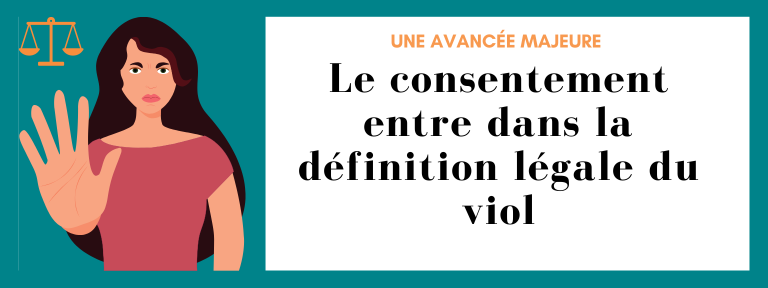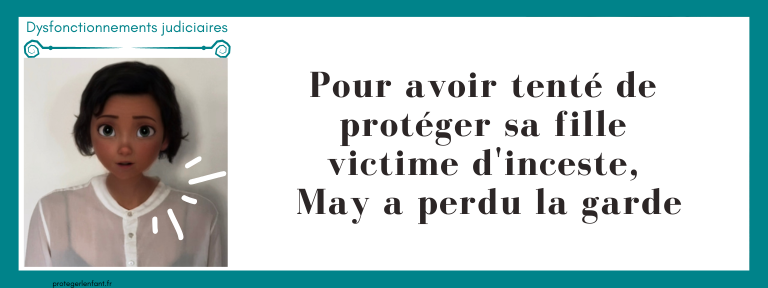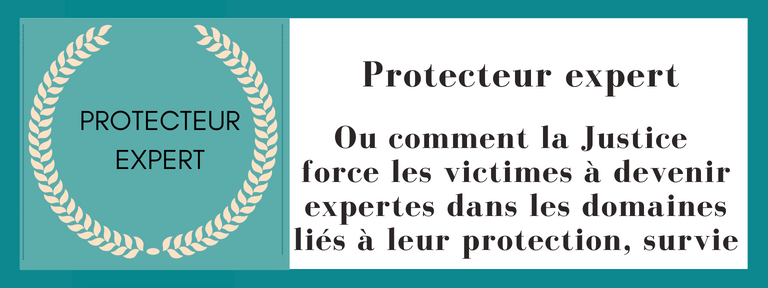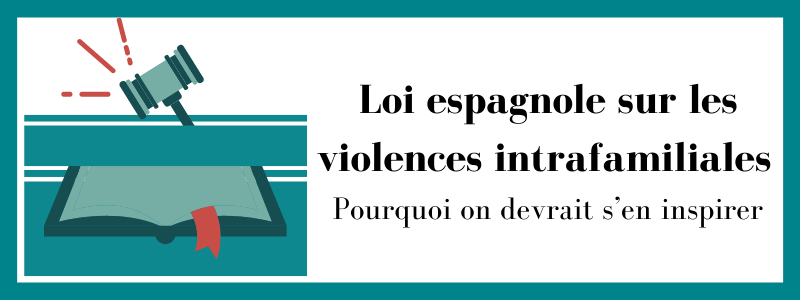Une avancée majeure
Contexte et justification de la réforme

La définition actuelle du viol en France repose sur l’article 222-23 du Code pénal : « tout acte de pénétration sexuelle … commis … par violence, contrainte, menace ou surprise ». Or, de nombreuses études et associations dénoncent l’insuffisance de ce cadre, notamment pour couvrir des faits où la violence physique ou la contrainte manifeste ne sont pas démontrables mais où la victime n’a pas pu ou su exprimer son refus. Une mission d’information de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, présidée par les députées Véronique Riotton (Ensemble pour la République) et Marie‑Charlotte Garin (Écologistes) a remis un rapport le 21 janvier 2025 recommandant d’intégrer explicitement la notion de « non-consentement » dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.
L’objectif affiché par ses auteurs et soutenu par le gouvernement est double :
- d’une part, mieux protéger les victimes et mieux reconnaître leurs situations de vulnérabilité, notamment dans les contextes intrafamiliaux, conjugaux ou d’emprise, en donnant à la justice un outil plus clair
- d’autre part, faire évoluer la culture judiciaire et sociale vers une logique de respect du consentement plutôt que de seul « refus ou violences visibles »
Inspirée par les législations de pays comme la Suède, l’Espagne ou le Royaume-Uni, cette proposition de loi (PPL) entend placer le consentement au cœur de la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, afin d’affirmer que l’absence de consentement suffit à caractériser le crime, sans qu’il soit nécessaire de prouver la violence.
Contenu de la proposition de loi
La PPL, déposée à l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025 par les députés Véronique Riotton et Marie-Charlotte Garin, modifie plusieurs articles du Code pénal, principalement les articles 222-22 et 222-23. En première lecture, en commission des lois, les deux députées ont été désignées comme co-rapporteurs. Au Sénat, les rapporteures sont Elsa Schalck et Dominique Vérien.
- Principales modifications législatives proposées
- Le texte propose de modifier les articles 222-22 (agressions sexuelles) et 222-23 (viol) du Code pénal pour y introduire la formulation-clé : « tout acte sexuel non consenti » commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur.
- Il définit le consentement « libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable » et précise que le silence ou l’absence de réaction ne peuvent valoir consentement.
- Il conserve les quatre critères actuels (violence, contrainte, menace, surprise) en les maintenant comme modalités dans lesquelles il n’y a pas consentement.
- Il élargit explicitement la définition du viol en y incluent les actes bucco-anaux.
NB : La PPL ne modifie pas les règles spécifiques applicables aux mineurs, déjà renforcées par la loi du 21 avril 2021 qui a établi un seuil d’âge de non-consentement à 15 ans (et 18 ans en cas d’inceste).
La redéfinition vise donc à clarifier le droit pénal et son application, harmoniser la législation française avec les standards internationaux et réaffirmer le rôle symbolique du droit comme un outil de transformation sociale.
Arguments clés et tendances des débats
Arguments favorables :
- Le texte est présenté comme une avancée majeure pour les victimes, en comblant une lacune législative
- Il s’inscrit dans les engagements internationaux de la France (ex. Convention d’Istanbul) qui recommandent la notion de non-consentement
- Il permet une meilleure cohérence entre réalité vécue des violences sexuelles et qualification pénale
Arguments opposés ou critiques :
- Certains juristes craignent que l’inscription du « non-consentement » entraîne une charge accrue sur la victime pour prouver l’absence de consentement.
- D’autres estiment que sans moyens supplémentaires (formation, enquête, prise en charge), la réforme resterait symbolique.
- Le débat a aussi porté sur la formule « appréciée au regard des circonstances environnantes » vs « contexte » selon la chambre.
Tendance politique : Le texte bénéficie d’un large consensus, notamment majoritaire gauche/droite-centre, ce qui traduit une convergence transpartisane sur ce sujet. Les oppositions se sont cantonnées essentiellement aux rangs de l’extrême droite ou de certains élus très critiques.
Parcours législatif et étapes à venir
- 21 janvier 2025 : dépôt de la proposition de loi à l’Assemblée nationale
- 26 mars 2025 : adoption en commission des lois de l’Assemblée nationale
- 28 mars 2025 : le Gouvernement engage la procédure accélérée, réduisant le nombre de lectures
- 1er avril 2025 : adoption en première lecture à l’Assemblée nationale, par 161 voix pour, 56 contre
- 18 juin 2025 : le Sénat adopte le texte en première lecture à l’unanimité (323 voix pour) sur le fond (avec modifications)
- 21 octobre 2025 : accord en commission mixte paritaire (CMP) entre les sénateurs et les députés
- 23 octobre 2025 : l’Assemblée nationale adopte le texte de compromis issu de la commission mixte paritaire, par 155 voix pour, 31 contre, 5 abstentions
- Étape suivante : vote définitif du Sénat (prévu 29 octobre 2025) avant promulgation et décrets d’application.
Impacts attendus et enjeux
La question du consentement dans les infractions sexuelles constitue un enjeu juridique et sociétal majeur, qui s’est retrouvé au cœur du débat public à plusieurs reprises ses derniers mois.
- Un impact juridique majeur : L’inscription explicite du consentement dans la loi permettra aux magistrats et enquêteurs de mieux qualifier les faits lorsque la victime n’a pas pu résister ou exprimer son refus, notamment en cas de sidération, d’empressé psychologique ou d’abus de vulnérabilité. Elle devrait aussi encourager les victimes à porter plainte, en réduisant le sentiment d’injustice ressenti lorsque la violence physique est absente. Cela permettra de contribuer à une meilleure prise en compte des violences, en particulier les violences intrafamiliales et conjugales où la contrainte n’est pas nécessairement visible.
Toutefois, certains juristes et députés soulignent que la réforme devra être accompagnée d’une formation renforcée des magistrats, pour éviter une incertitude jurisprudentielle sur l’interprétation du « non-consentement ».

- Un impact social et symbolique fort : En inscrivant le consentement comme condition essentielle, le texte envoie un signal fort : « aucun acte sexuel sans consentement ne peut être toléré ». La ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes a qualité ce texte de « pas décisif vers une véritable culture du consentement ». Il s’agit d’un tournant symbolique pour la société, le viol n’est plus seulement une question de violence physique, mais avant tout une atteinte à l’autonomie sexuelle de la personne.
Cette évolution s’inscrit dans la prolongement des mobilisations sociales des dernières années (#MeToo, #NousToutes, campagnes sur le consentement) et renforce la cohérence du cadre législatif français avec les politiques de prévention et d’éducation à la sexualité.
- Conséquences pratiques. Plusieurs défis demeurent tels que :
- La formation des professionnels de la justice, des forces de l’ordre (adaptation des formations initiales et continues).
- La garantie de l’effectivité de cette réforme, en raison des voix critiques qui estiment que cette réforme pourrait, sans accompagnement, faire peser la charge de la preuve sur la victime ou ne pas suffire à changer les pratiques judiciaires.
- Un travail de sensibilisation auprès du grand public et des jeunes.
- Une meilleure articulation entre la justice, les services sociaux et les associations d’aide aux victimes.
Conclusion
En intégrant explicitement la notion de non-consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles, elle aligne la France sur les standards européens et affirme un principe fondamental : aucun acte sexuel ne peut être imposé sans un consentement libre, éclairé et réversible. Son impact sera donc à la fois juridique, en clarifiant la qualification des faits ; symbolique, en réaffirmant la dignité et l’autonomie des personnes ; et social, en renforçant la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales.
En voie d’adoption définitive, cette proposition de loi constitue une évolution majeure du droit pénal français. Hautement symbolique, le texte marque un changement d’époque. L’enjeu dépasse la seule modification du Code pénal : il s’agit d’une transformation culturelle, vers une société fondée sur le respect du consentement et de l’intégrité de chacun.
Sa réussite dépendra toutefois de la formation des professionnels, de la mise en œuvre concrète dans les tribunaux et de la coordination avec les associations de terrain. Il est donc très important que cette réforme ne reste pas lettre morte et il faudra veiller à ce que les modalités d’application soient bien définies.